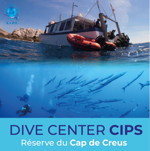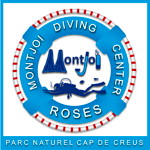Un modèle de
décompression est une représentation simplifiée des phénomènes physiologiques liées à la
dissolution des gaz dans l'organisme du
plongeur en immersion et notamment à la
désaturation de ces gaz à la
remontée.
Modéliser ces phénomènes complexes permet d'établir des protocoles de
plongée afin d'éviter les
accidents de
décompression.
A partir de ces modèles il est possible d'élaborer des tables de
décompression (tables de
plongée) ou des algorithmes pour les
ordinateurs de
plongée.
C'est John Scott
Haldane qui a élaboré la première table de
décompression par
paliers en 1908 à partir du modèle qui porte son nom, le modèle haldanien.
Le modèle haldanien repose sur 4 hypothèses principales faites par
John Scott Haldane à la suite de ses expérimentations :
1 - L'équilibre des
pressions au
niveau alvéolaire est instantané
2 - L'équilibre des
pressions au
niveau des
tissus est instantané
3 - Le corps humain est représenté par 5 régions anatomiques fictives , appelées compartiments, caractérisés par leurs
périodes.
4 - La charge et la décharge sont symétriques, c'est à dire que la phase d'élimination de l'azote est strictement inverse de la phase d'absorption.
A ces hypothèses s'ajoutent notamment que la vitesse de
remontée est de 10m/minutes, que le seuil de
sursaturation critique égale à 2 est le même pour tous les compartiments et que les compartiments sont considérés en parallèle sans interaction entre eux.
Le modèle de
Haldane est qualifié de modèle mathématique et de modèle par perfusion en raison de ses considérations reposant sur la loi de
Henry. Bien que très simplifié au regard des phénomènes physiologiques, il est remarquablement satisfaisant pour des
plongée simples, mais n'évite pas les
accidents pour les
plongées profondes ou les
plongées succéssives.
Depuis, d'autres modèles de
décompression ont été élaborés, soit en améliorant le modèle haldanien, soit en recherchant des approches nouvelles afin de mieux prendre en compte les phénomènes physiologiques et mieux répondre à la
sécurité des différents profils de
plongée.
Parmi les modèles haldaniens ou dérivés du modèle haldanien, citons :
- celui de l'US Navy (1957) qui ajoute au modèle hadanien un 6ième compartiment et des seuils de
sursaturation critique par compartiments.
- celui de Workman, établi en 1965, qui prend en compte pour chaque compartiment des seuils de
sursaturation critique en fonction de la
profondeur et permet ainsi de réaliser des tables pour les
plongées longues et profondes.
- celui de Bühlmann, établi en 1983, améliorant le modèle de Workman en ajoutant la prise en compte de la
pression absolue et la composition de l'air alvéolaire. Ce modèle est utilisé pour les algorithmes de nombreux
ordinateurs.
- celui des tables MN90 qui prend en compte 12 compartiments ayant chacun un seuil de surtasuration critique propre. Ce modèle a été élaboré par la Marine Nationale en 1990, d'ou l'appellation MN90.
- celui de la
COMEX, établi en 1992, répondant aux besoins des travailleurs
hyperbares avec les tables MT92.
Parmi les modèles non-haldaniens, citons :
- le modèle par
diffusion prenant en compte la résistance mécanique des
tissus lors des phases d'absorption et d'élimination de l'azote d'un seul compartiment. Les tables du British Sub Aqua Club repose sur sur ce modèle.
- le modèle avec compartiment en série prenant en compte les échange de gaz entre compartiments utilisé dans les tables DCIEM au Canada.
- le modèle
RGBM élaboré par le Dr Bruce Wienke qui prend en compte les noyaux gazeux, ces bulles microscopiques qui provoquent la formation de bulles lors de la
désaturation. Ce modèle est repris sur certains
ordinateurs de
plongée.